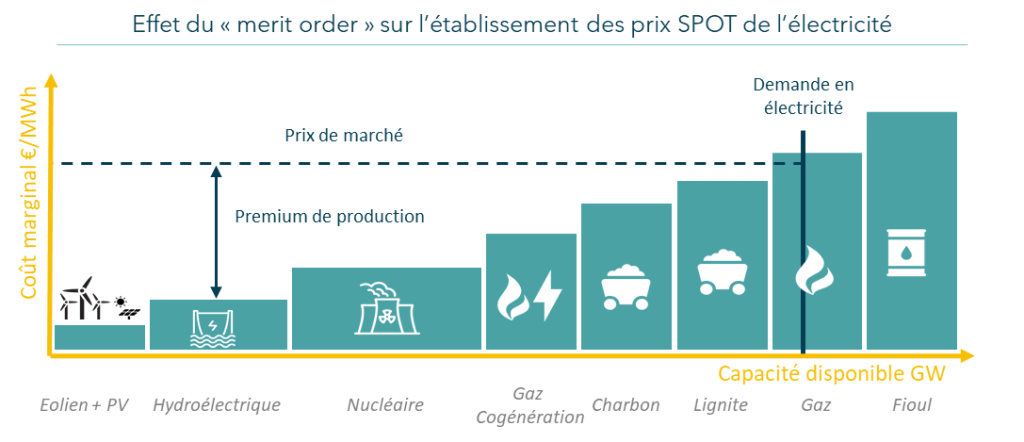Qu’il s’agisse d’épluchures ménagères, d’engrais de ferme ou de bois, la biomasse contient une énergie précieuse exploitable sous forme d’électricité, de chaleur ou de carburant. « La valorisation de la biomasse se situe à cheval entre le traitement des déchets et la production d’énergie » illustre Yves Membrez de Biomasse Suisse. L’énergie issue de la biomasse est quant à elle renouvelable et neutre en CO2. « En Suisse, elle est en outre également durable, précise l’OFEN, car avant de produire de l’énergie, la matière organique est utilisée une première fois pour l’alimentation, humaine et animale, ou comme matériau de construction ».
Dans le cadre du programme d’encouragement Energie 2014-2021, financé à hauteur de 250 millions par la Confédération, la revue Diagonale (février 2022) de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) nous apprend que 1300 spécialistes, dont ceux du WSL, ont exploré les solutions techniques, sociétales et politiques en vue de la transition énergétique et d’une production d’énergie plus durable. Depuis de nombreuses années, l’Institut fédéral collecte des données et a ainsi développé des modèles de simulation pour évaluer la disponibilité de chacune des sources d’énergie renouvelable : la biomasse, l’eau, le vent et le soleil. Résultat : les substances organiques comme le bois, les produits de la fauche, le fumier et le lisier recèlent un trésor d’énergie. « La biomasse est un précieux substitut aux combustibles et carburants fossiles. Elle est de toute façon présente et peut être transformée en énergie de manière efficiente », explique Oliver Thees, chercheur en sciences forestières et économiste du WSL. La contribution énergétique des biomasses – ligneuses et non ligneuses – pourrait s’élever à 27 TWh d’énergie par an.
La biomasse, c’est quoi ?
Comme expliqué dans cette courte vidéo, la biomasse désigne tout ce qui se compose de matière organique renouvelable, telle que les déchets verts et les épluchures des zones d’habitation, les résidus de récoltes et les engrais de ferme en agriculture ou encore les déchets alimentaires de la restauration. Toutes ces matières peuvent être transformées en biogaz et permettent de produire de l’électricité, de la chaleur et du carburant pour la mobilité. Plus de 13’500 véhicules à gaz sont actuellement en circulation sur les routes Suisses selon l’association Suisse de l’Industrie gazière (ASIG), un chiffre encore relativement confidentiel, au vu des 6,4 millions de véhicules routiers à moteur immatriculés en Suisse.
En 2020, un cinquième de l’énergie renouvelable provenait de la biomasse selon SuisseEnergie. Et pour le petit clin d’œil, le site Futura science nous rappelle très justement que « la première forme d’exploitation de la biomasse est l’activité physique. La transformation des aliments en énergie musculaire a longtemps été l’une des principales sources d’énergies des économies, jusqu’à l’industrialisation ».
La biomasse sèche et humide
L’OFEN – entre autres – classe la biomasse en deux catégories :
- La biomasse ligneuse sèche (bois de forêt, de récupération, etc.) : elle est la plus ancienne source d’énergie et représente le 85% de l’énergie provenant de la biomasse en Suisse. Elle est transformée en énergie par le biais de la combustion ou la gazéification.
Comment on obtient de l’énergie ?
La combustion consiste à brûler le bois pour la production de chaleur (traitement thermique), alors que la gazéification transforme la biomasse sèche en gaz de synthèse. Cette transformation thermochimique consiste à décomposer par la chaleur (plus de 1000°C) une biomasse sèche en présence d’un réactif gazeux (gaz carbonique, vapeur d’eau puis oxygène/air). Ce combustible, gaz de synthèse au mélange de monoxyde de carbone et d’hydrogène, peut alimenter un moteur thermique pour produire de l’électricité ; la chaleur résultant du processus peut également être valorisée dans un réseau le chauffage à distance. La production simultanée de chaleur et d’énergie s’appelle la cogénération.
La commune de Puidoux et Romande Energie ont misé sur cette approche avec une installation mise en service en 2018. La centrale couvre l’équivalent des besoins annuels en électricité de 1’500 ménages. La centrale Enerbois, fruit d’un partenariat entre Romande Energie et la scierie Zahnd (Rueyres) est également un exemple du genre. Plus grande centrale de biomasse de Suisse romande, elle génère 26.5 millions de kWh d’électricité par année – la consommation de plus de 7’500 ménages – en brûlant les sous-produits de la scierie Zahnd (écorces et plaquettes), alors que la chaleur est valorisée sur site pour les différents processus industriels. Avec la sciure de bois issue de la scierie (un autre sous-produit), Enerbois produit par ailleurs plus de 18’000 tonnes de pellets par an, de quoi chauffer environ 4’500 ménages.

Enerbois, la plus grande installation biomasse de Suisse.
© Romande Energie.
- La biomasse humide et peu ligneuse (biodéchets, lisier et fumier, résidus de récolte, boues d’épuration, etc.)
Le procédé biochimique appelé méthanisation (ou digestion anaérobie) permet de transformer la biomasse humide en biogaz, pour la production de chaleur et d’électricité. Les principaux producteurs de biogaz en Suisse à partir de biomasse humide sont les stations d’épuration (STEP).
Comment on obtient de l’énergie ?
La biomasse humide est transformée en gaz dans des digesteurs (grandes cuves) contenant des bactéries anaérobies (actives en l’absence d’oxygène). La charge organique est alors décomposée pour produire du gaz renouvelable (ou biogaz). Il peut être soit directement utilisé comme source d’énergie, soit utilisé dans des centrales de cogénération pour produire de l’électricité et de la chaleur. Il peut également être purifié avant d’être distribué dans le réseau de gaz et il est aussi transformable en biométhane pour servir de carburant. Toutefois, si la production de biogaz à partir de biomasse humide avait autrefois le vent en poupe, son développement ne s’est pas poursuivi de manière soutenue, comme l’explique Yves Membrez de Biomasse Suisse, directeur du bureau d’étude et de conseils EREP SA. Cet ingénieur civil est spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets et effluents organiques depuis plus de 40 ans. « Quand j’ai commencé mes activités dans les années 1980, la Suisse comptait environ 150 sites de production de biogaz agricoles. Mes collègues suisses allemands avaient l’habitude de dire que par rapport au nombre d’habitants, nous étions le pays industrialisé avec le plus grand nombre d’installations. Aujourd’hui il en reste environ 120. » Il précise que l’énergie est devenue ensuite très bon marché et que les agriculteurs, subissant de fortes pressions, avaient alors d’autres priorités que celle de développer des usines de production de biogaz sur leurs exploitations. « Il faudrait aujourd’hui une politique résolue et concertée pour que la biomasse prenne de l’ampleur, ce qui manque encore » ajoute-t-il.
Quand y en a plus, y en a encore
Le digestat : en effet, dans le cadre d’une fermentation anaérobie de la biomasse humide, tout ce qui n’est pas facilement décomposable se retrouvera à la sortie. C’est le digestat, que l’on trouve sous forme solide ou liquide. Riche en nutriments tels que l’azote, le phosphore et le potassium, il peut se composter ou servir d’engrais pour l’agriculture. En Suisse, environ 300 000 m3 de digestat liquide sont produits annuellement dans les installations de méthanisation. Cependant, toute la biomasse humide n’est pas valorisable, comme le précise Yves Membrez de Biomasse Suisse. « Les digestats qui viennent des boues d’épuration ne peuvent être utilisés dans l’agriculture. C’est interdit en Suisse pour des raisons qui remontent à la vache folle, mais aussi parce qu’on n’a pas encore de solutions pour supprimer les résidus médicamenteux présents dans les eaux usées – même si l’idéal serait de ne pas les y mettre. On peut toutefois épandre le digestat qui résulte des autres sources de biomasse humide. »
Le biochar : principalement produit à partir de résidus de bois, le biochar (ou charbon végétal) est un produit dérivé de la pyrolyse de la biomasse, soit la conversion thermique de la matière organique en l’absence d’oxygène. Il peut être utilisé entre autres pour améliorer la fertilité des sols, retenir l’eau et les nutriments, stimuler la croissance des plantes et réduire le recours aux engrais chimiques. Le biochar peut également contribuer à la séquestration du carbone dans les sols.

Joëlle Loretan
Rédactrice