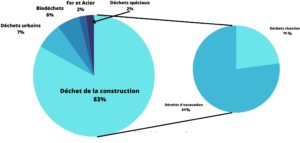La ville du quart d’heure : Réinventer l’urbanisme pour un futur durable
Le concept de la ville du quart d’heure représente une révolution dans l’urbanisme, visant à créer des villes à la fois durables et où il est plus agréable de vivre. Découvrez pourquoi ce concept est crucial pour l’avenir de nos villes et comment il peut transformer notre quotidien. Transformer les villes actuelles vers ce modèle nécessite des changements significatifs en termes d’urbanisme et de politique.
Qu’est-ce qu’une Ville du quart d’heure ?
L’urbaniste franco-colombien, Carlos Moreno, a introduit ce concept pour répondre aux défis urbains modernes, promouvant un urbanisme centré sur les besoins humains. Ce concept de ville vise à réduire les déplacements en rendant tous les services essentiels accessibles en quinze minutes de marche ou de vélo.
Face aux défis environnementaux et à l’augmentation des embouteillages, ce modèle offre une solution pour créer des villes plus durables et moins dépendantes des transports. En effet, ce modèle s’oppose au modèle post-industriel où les villes étaient séparées en trois centres urbains : un centre de vie avec des logements, un centre d’affaires avec les magasins, les bureaux et l’industrie et un centre de loisirs avec les installations sportives et culturelles. La voiture étant nécessaire pour passer d’un centre à l’autre.
Comment réduire les trajets en ville ?
La clé réside dans la création de quartiers autosuffisants où les résidents peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin à proximité. Cette stratégie implique de partager des espaces pour différents usages, optimisant ainsi l’utilisation des ressources urbaines. La ville du quart d’heure vise à réduire les déplacements en ville en rendant tous les services essentiels accessibles en 15 minutes de marche ou de vélo. Par « services essentiels » nous entendons les logements et les magasins alimentaires, bien sûrs, mais aussi les écoles, les crèches, les infrastructures propres aux activités de loisir, qu’elles soient culturelles ou sportives, ou encore les espaces verts. Il faut donc penser aussi à des immeubles multifonctionnels qui pourraient avoir des logements, des bureaux, des crèches et/ou des magasins.
Ces quartiers multifonctionnels permettent aux personnes de vivre, travailler, se divertir et d’accéder aux services de santé, d’éducation et de loisirs, sans avoir besoin de se déplacer loin de chez elles. Cette proximité rend moins dépendant de la voiture ou d’autres moyens de transports motorisés, tels que les transports publics, et permet ainsi de réduire les déplacements pendulaires.
Les bénéfices environnementaux et sociaux du modèle
En réduisant les déplacements motorisés, ce modèle peut significativement limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc améliorer la qualité de l’air urbain, tout en nous permettant de lutter contre le réchauffement climatique.
Ce concept favorise aussi la cohésion sociale et offre un cadre de vie enrichissant et diversifié. En permettant aux gens de vivre près de chez eux, on augmente les interactions sociales au sein de ce microcosme. Chacune et chacun étant bien évidemment libre d’en sortir !, il va s’en dire que le contact humain est plus aisé à pied ou à vélo et qu’on échange volontiers avec une personne rencontrée ici puis là. D’aucuns estiment d’ailleurs que les principales infrastructures devraient se trouver au maximum à 15 minutes à pied et à moins de 15 minutes à vélo. Les outils de la « ville intelligente » pourraient d’ailleurs aider les urbanistes à optimiser les déplacements pour tendre vers une ville idéale.
Conclusion : Vers des villes plus humaines et durables
La ville du quart d’heure représente un pas vers des villes polycentriques où les services sont répartis de manière plus équilibrée. Un pas vers des villes plus résilientes, centrées sur le bien-être humain.
Points clés à retenir
· Accessibilité et proximité : réduire la dépendance aux transports polluants pour que tout soit accessible à pied ou à vélo dans un rayon de 15 minutes.
· Innovation urbaine : le partage des espaces pour optimiser les ressources et créer des communautés plus intégrées.
· Bienfaits environnementaux et sociaux : moins d’émissions de gaz à effet de serre et une meilleure cohésion sociale.